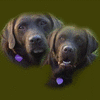-
Votre feuilleton du week-end 6

Semaine 6
Philippe Delyon ne peut pas regarder Philippe Tchang, fillette fluette et pâle, sans manifester son acrimonie. Cette gamine est une insulte à la virilité de son prénom. D’autant plus qu’elle n’a rien d’un garçon manqué la fifille-à-sa-maman ! Il ne décolère plus. La stupidité des parents le met hors de lui et madame Delyon paie sa mauvaise humeur – mais, en douce, elle rit bien.
Alice, notre voisine, vient de rentrer au moment où le soleil attiédit l’air. Le printemps approche. Elle n’a d’ailleurs pas hésité à entrouvrir la porte-fenêtre du salon en début d’après-midi.
Son escapade à Saumur aurait dû la requinquer. Mais une vieille histoire de famille, que lui a contée son hôtesse, l’a beaucoup perturbée et quelque peu affolée, à tort bien sûr. Il a été question de grands-tantes disparues avant et après la guerre, dans un gros bourg de l’ouest.
Sa méchanceté invétérée, insupportable aux autres, avait conduit les bonnes sœurs à reléguer (si nous pouvons ainsi dire) Marie Meurgeon dans l’une de ces maisonnettes qu’elles réservaient à quelques vieillards plus aisés. La bâtisse de dimensions modestes présentait davantage l’apparence extérieure d’une chaumine que celle d’une coquette retraite. Toutefois une heure ou deux par jour
 le soleil
balayait son seuil, ce qui représentait un privilège non négligeable comparé aux lacis de venelles ombreuses qui sillonnaient l’hospice. Car les religieuses semi cloîtrées se cachaient derrière
un labyrinthe de hauts murs. Elles les franchissaient au moyen de passerelles qui les dissimulaient aux regards des visiteurs. Seuls les pensionnaires et les enfants de l’orphelinat les
approchaient. On entrait en ce lieu comme au purgatoire. La joie vous quittait aussitôt que vous en franchissiez le portail. Aussi le moindre rayon de lumière vous transportait-il au
paradis.
le soleil
balayait son seuil, ce qui représentait un privilège non négligeable comparé aux lacis de venelles ombreuses qui sillonnaient l’hospice. Car les religieuses semi cloîtrées se cachaient derrière
un labyrinthe de hauts murs. Elles les franchissaient au moyen de passerelles qui les dissimulaient aux regards des visiteurs. Seuls les pensionnaires et les enfants de l’orphelinat les
approchaient. On entrait en ce lieu comme au purgatoire. La joie vous quittait aussitôt que vous en franchissiez le portail. Aussi le moindre rayon de lumière vous transportait-il au
paradis.
Marie Meurgeon profitait jalousement de cet avantage. Elle entretenait avec méticulosité les deux pièces de son logis. Aux beaux jours, des pétunias et des géraniums ornaient les pots qu’elle serrait sur le rebord des fenêtres ou posait en équilibre au sommet des bouteroues qui encadraient l’entrée. Elle pouvait à son gré cuisiner ou bien prendre ses repas à la cantine.
Aussitôt arrivée dans cet établissement, Clarisse Labbat, sa cousine, douce et secrète, avait été séparée de son mari dont elle partageait la couche depuis quarante-sept ans. Chacun avait rejoint le dortoir assigné à son sexe. Ici toute intimité était bannie. Ils échouèrent dans la promiscuité d’étrangers et de vagues connaissances. Désormais leur existence se trouva réduite aux limites d’une table de nuit, d’un lit et d’une étroite penderie, exposée au su et au vu de tous. Les emprunts russes avaient ruiné les économies de leur labeur. Qui leur aurait prédit une fin aussi misérable ?
Lorsque le temps le permettait ils s’évadaient à la campagne au bras l’un de l’autre et croyaient, pendant la durée d’une promenade, qu’ils allaient libres et heureux. Mais quand les ombres s’étendaient au-dessus des chemins creux, que l’heure approchait de rentrer, un grand chagrin les étreignait. La nuit de nouveau allait les séparer.
Parfois, alors qu’elle rendait visite à sa cousine, Clarisse ne parvenait plus à contenir ses larmes. Marie Meurgeon haussait les épaules : qu’y pouvait-elle si son mari et elle n’avaient pas su mener leurs affaires ? Et puis elle avait autre chose à faire que d’écouter des jérémiades. Il y avait assez d’oreilles là-bas pour l’entendre. Clarisse n’osa plus se plaindre.
La douleur emporta Mathurin Labbat le premier. Dès lors Marie Meurgeon inventa mille excuses et obligations pour ne plus recevoir sa cousine. Clarisse, seule et malheureuse, errait du cimetière aux champs, persuadée que l’âme de son cher époux l’accompagnait.
L’arrivée de l’hiver glaça encore davantage son cœur. Un jour de neige et de givre elle s’en fut sous le ciel blême. Elle marcha droit devant elle, encore et encore, entre les haies chargées de lourds flocons. On la retrouva le lendemain soir, recroquevillée au pied d’un châtaigner, les yeux ouverts, comme illuminée d’un bonheur éternel.
Marie Meurgeon mourut onze ans après, paisiblement pendant son sommeil, une belle nuit d’été.
Quand elle évoque ce drame, Alice frémit encore. Mais aussitôt elle se rassure. Nous ne sommes plus à l’époque des hospices ! Qui plus est ses rentes devraient lui assurer des vieux jours à l’abri du besoin. Et puis elle est encore jeune et en pleine forme. Autant en profiter !
N.B. Ceci est une fiction
Emprunts russes, pour en savoir plus
 Tags : d’un, mari, meurgeon, jour, clarisse
Tags : d’un, mari, meurgeon, jour, clarisse
-
Commentaires