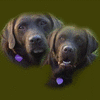-
Par margareth le 9 Juin 2012 à 05:54

La toute puissance de l’envahisseur sur le déclin se crispait. Le 18 juin 1943 Préfailles était « tout remué par le départ des jeunes classes ». Autour des demoiselles Pochon et de leurs connaissances les garçons insoumis étaient enlevés, expédiés en Allemagne ou sur les chantiers de l’Atlantique. La France grondait en sourdine parce qu’elle éprouvait chaque jour davantage le sentiment d’être un peuple de prisonniers. Le fils Delyon s’était évaporé dans la nature pour échapper au STO. Outrée par la multiplication des violences de l’occupant, Sixtine s’était enfin résolue à rejoindre Félicité. Elle logerait chez les Drouet, au centre de Nantes.
De cette vaste maison, de ce jardin où l’on respirait un air nouveau, maman Tine se désolait de n’avoir que la crème du lait à étaler sur les tartines du petit déjeuner. Les trois enfants (Riri, Jeannette, Rémi) protestaient, réclamaient à grands cris le bon beurre doré que cousine Lène envoyait quelquefois (enveloppé dans un linge imbibé de vinaigre par temps de canicule). Maman Tine en riait. Seuls comptaient leurs petits bidons ! Faute d’autre matière grasse, elle cuisait les patates avec des lardons. Ils adoraient cela ! D’où que soufflât le vent, son optimisme ne fléchissait jamais. Non, il ne fallait pas s’émotionner ; oui, l’issue du cauchemar approchait. Elle réitérait son invite. « Si vous avez besoin de repos, nous sommes là. » En cet été 1943 les lettres que recevait Hélène répétaient comme en écho que la fin était peut-être plus proche qu’on le croyait. Certain après-midi d’août un orage d’une violence inhabituelle avait déchiré l’étendard à croix gammée qui flottait sur la façade de l’hôtel particulier depuis trois ans. Yvonne et Hélène y avaient vu comme un présage de la déroute allemande.
Hélas ! L’espoir bientôt vacilla. Septembre 1943 fut tragique à bien des titres. En premier lieu un télégramme informa mesdemoiselles Pochon que madame Le Chahier avait été victime d’une attaque cérébrale. Liselotte appelait leur aide car la vieille dame, aussi entêtée que son grand-oncle, refusait, quoi qu’il arrivât, de quitter Préfailles. Yvonne remua ciel et terre, contourna tous les interdits pour rejoindre sa grand-mère et résider près d’elle. Le 8 septembre 1943 l’Italie signait sa reddition aux alliés. Les allemands envahissaient Nice. Une lettre arriva chez les Dessablettes. Les juifs avaient été piégés dans Nice. En dépit de ses efforts, la tante de Marie-Thérèse n’avait pas réussi à sauver madame X. de la déportation. Les 16 et 23 septembre, des bombardements désastreux ravageaient Nantes. Hélène se retrouvait seule au milieu des occupants de son immeuble. Elle acheta un chien, un grand bâtard ébouriffé –Toufou- qui aurait pu passer pour un luxe en cette période de disette, mais il lui était un réconfort et une compagnie.
Le ciel, radieux à Nantes ce 16 septembre 1943, invitait à la flânerie. Sixtine, libre cet après-midi-là, déambulait du côté de la rue Crébillon. Il lui avait semblé reconnaître Félicité Dessablettes au bras d'un allemand place Graslin. Mais ce genre de relation était inimaginable de la part de son amie. Son esprit défiant lui inspirait des idées mal venues.
On se pressait sur les trottoirs dans la tiédeur de ce beau jeudi d’arrière-saison. Des mères
 promenaient leurs enfants. Sixtine s’était éloignée de ce quartier et se dirigeait vers le château. Il eut une première alerte qui ne précipita pas la foule vers les abris. Les gens se mettaient aux fenêtres, levaient le nez pour identifier les avions qui se dirigeraient, croyaient-ils, vers Saint-Nazaire. La deuxième alerte retentit. Alors, pendant un quart d’heure, l’enfer se déversa du ciel sur le centre de Nantes. Sixtine s’était réfugiée au fond d’un porche pour se protéger des éclats. Un roulement continu faisait trembler le sol, la pluie de bombes arrosait la ville avec un bruit métallique, les explosions éventraient les immeubles au milieu des hurlements. Puis ce fut le silence. Effrayant. Des fumées s’élevaient dans le quartier de la place Royale. La jeune fille, tremblante, revint sur ses pas.
promenaient leurs enfants. Sixtine s’était éloignée de ce quartier et se dirigeait vers le château. Il eut une première alerte qui ne précipita pas la foule vers les abris. Les gens se mettaient aux fenêtres, levaient le nez pour identifier les avions qui se dirigeraient, croyaient-ils, vers Saint-Nazaire. La deuxième alerte retentit. Alors, pendant un quart d’heure, l’enfer se déversa du ciel sur le centre de Nantes. Sixtine s’était réfugiée au fond d’un porche pour se protéger des éclats. Un roulement continu faisait trembler le sol, la pluie de bombes arrosait la ville avec un bruit métallique, les explosions éventraient les immeubles au milieu des hurlements. Puis ce fut le silence. Effrayant. Des fumées s’élevaient dans le quartier de la place Royale. La jeune fille, tremblante, revint sur ses pas.La rue du Calvaire (qui en l’occurrence portait bien son nom) était rasée. Non loin de là, la maison du Dr Drouet ne présentait plus qu’une cavité béante qui vomissait une coulée de gravats jusqu’au bord opposé de la chaussée. Des flammèches couraient sur les poutres. Qu’étaient devenus ses habitants ? Des hommes s’activaient sur ses ruines. Sixtine les interrogea. Deux corps de femmes, méconnaissables, avaient été dégagés. Ils recherchaient le médecin et ses patients.
Tous avaient été tués. Elle n’avait plus ni toit ni amis.
Il lui avait fallu un long moment pour se reprendre. Frappée d’hébétude. Comme si elle avait été précipitée sans transition du passé dans le futur. En un clin d’œil le passé de milliers de personnes venait d’être éradiqué. Le souvenir de Félicité lui revint et elle s’inquiéta de son amie. Derechef elle marcha vers le quartier de l’église Sainte-Croix. Félicité ne répondait pas. La concierge consultée lui indiqua que mademoiselle Dessablettes avait quitté son domicile avant midi avec son fiancé. « Son fiancé ? reprit Sixtine.
—Oui, Gérard Marin.
—Ah ! Bien sûr » balbutia Sixtine prise de court. Elle poursuivit sa quête jusqu’à l’hôtel-Dieu où elle découvrit un malheur. Quelqu’un lui répondit que mademoiselle Dessablettes avait rejoint ses malades rescapés à l’hôpital Saint-Jacques, au-delà de Pirmil. On l’interpella : « Eh ! Mademoiselle Pochon ! Qu’est-ce que vous faites ? On a besoin de vous ! » Cet appel était une source fraîche au milieu du désert. Un secouriste de son équipe avançait vers elle. Ensemble ils rejoignirent leur groupe.
Tant au R. qu’à Préfailles, chacun se faisait du souci pour les siens. Les dernières nouvelles en provenance de Nantes dataient de l’intervalle entre les deux journées de bombardements des 16 et 23 septembre. Ceux qui avaient survécu au premier bombardement avaient-ils réchappé du second ? Leurs familles s’étaient peut-être réjouies trop tôt. Que devenaient Sixtine et Félicité ? Madame Le Chahier avait entendu sur Radio Marseille que les églises Saint-Nicolas et Sainte-Anne, à proximité desquelles résidaient de ses amis, étaient en ruines. Personne ne savait comment joindre les enfants et les vieillards évacués de la ville sinistrée.
Le 30 septembre Liselotte avait remis une dernière enveloppe à l’un de leurs commissionnaires. Elle précisait qu’il était désormais inutile d’envoyer des colis à Préfailles car on n’y recevait plus les lettres et les journaux.
NB : Ceci est une fiction 6 commentaires
6 commentaires
-
Par margareth le 2 Juin 2012 à 05:49

Les trois sœurs, par fidélité à la promesse faite par leurs parents à Adélaïde Pochon de ne jamais abandonner son ancien majordome, se relayaient au chevet d’Alcide. Un après-midi Sixtine avait bavardé avec lui de choses et d’autres. Il était alité mais ses idées demeuraient claires. Or, arrivée chez elle, elle avait appris que les religieuses venaient d’appeler. Alcide avait rendu l’âme juste après son départ. Pour sa consolation elle se dit que sa présence avait sans doute adouci ses derniers moments.
 Alcide n’avait aucune famille proche ou lointaine. Pour ses funérailles mesdemoiselles Pochon lui en tinrent lieu. Depuis tant de décennies qu’il travaillait au château, il était devenu une figure notoire du R. Aussi la chapelle de l’hospice avait à peine suffi à contenir le nombre de ceux qui avaient voulu lui rendre un dernier hommage. Il avait désigné Yvonne comme sa légataire universelle, à charge pour elle de répartir ses quelques biens entre ses sœurs, Honorine et elle-même. Elles retrouvèrent des souvenirs émouvants qu’il avait reçus autrefois à l’occasion de la communion des enfants, épingles de cravate, images pieuses et un missel signé Lesort relié de cuir brun, estampé à l’or fin et qui, sur la soie des pages de garde, portait ses initiales en lettres gothiques. Sixtine insista pour l’avoir. Yvonne attribua à Honorine sa chambre, sa table ronde et ses deux chaises d’acajou. Hélène choisit les deux vases en laiton repoussé, ornés de rameaux de chêne, qu’il avait rapporté des tranchées. Yvonne utilisa son pécule (qui n’était pas négligeable) pour payer sa pierre tombale, la concession à perpétuité et pour faire dire des messes pour son salut éternel.
Alcide n’avait aucune famille proche ou lointaine. Pour ses funérailles mesdemoiselles Pochon lui en tinrent lieu. Depuis tant de décennies qu’il travaillait au château, il était devenu une figure notoire du R. Aussi la chapelle de l’hospice avait à peine suffi à contenir le nombre de ceux qui avaient voulu lui rendre un dernier hommage. Il avait désigné Yvonne comme sa légataire universelle, à charge pour elle de répartir ses quelques biens entre ses sœurs, Honorine et elle-même. Elles retrouvèrent des souvenirs émouvants qu’il avait reçus autrefois à l’occasion de la communion des enfants, épingles de cravate, images pieuses et un missel signé Lesort relié de cuir brun, estampé à l’or fin et qui, sur la soie des pages de garde, portait ses initiales en lettres gothiques. Sixtine insista pour l’avoir. Yvonne attribua à Honorine sa chambre, sa table ronde et ses deux chaises d’acajou. Hélène choisit les deux vases en laiton repoussé, ornés de rameaux de chêne, qu’il avait rapporté des tranchées. Yvonne utilisa son pécule (qui n’était pas négligeable) pour payer sa pierre tombale, la concession à perpétuité et pour faire dire des messes pour son salut éternel.Dans la grisaille de l’hiver s’installa la tristesse. On souffrait de froid, de faim, de peur, de la séparation d’avec des êtres chers. La gare avait été mitraillée. Plusieurs obus étaient tombés dans le vallon. Ils avaient provoqué des éboulements qui en avaient modifié la topographie. Le tunnel qui menait au ruisseau était détruit. Hélène se démenait pour procurer à leurs amis parisiens ce qui leur faisait défaut. Dans un mot signé R.C. l’un d’eux constatait : « La factrice n’a jamais distribué autant de colis. »
Madame Niessl s’étira comme pour extirper son esprit du passé et reprendre pied dans le présent. De nouveau les lettres et les documents du laque présentaient une lacune de plusieurs mois que rien n’expliquait. Maintenant qu’elle avait épousé Hans Niessl, elle aurait pu renoncer à travailler. Mais elle refusait d’abandonner un projet qui lui avait tant tenu à cœur.
Elle se leva puis se dirigea vers le salon de thé où Benedict officiait. Le jeune homme étudiait l’histoire de l’art à Tours. Elle l’avait engagé à temps partiel depuis Pâques. C’était un garçon cultivé, débrouillard sur lequel elle fondait de sérieux espoirs. Un jour il la seconderait dans l’achat et la vente d’œuvres d’art.
Toutes les tables étaient occupées. Les Delyon la saluèrent de loin (s’ils avaient su ce qu’elle venait de lire !) Leur fils Laurent les accompagnait. A cet instant un détail la frappa. Laurent Delyon ressemblait à son père, certes, mais quelque chose dans sa physionomie lui rappelait d’autres traits, une expression qu’elle ne parvenait pas à attribuer. Qui pouvait-il bien lui rappeler ?
Adèle Niessl n’arrivait pas à reconstituer la suite logique des événements depuis le début de l’année 1943. Des photos de Paris (le Luxembourg, le Sacré Cœur, l’Arc de Triomphe) et une invitation ni datée ni signée à s’y rendre brouillaient les pistes. Les épreuves accréditaient le séjour d’Hélène dans la capitale. Mais était-ce avant, pendant ou après la guerre ? Adèle ne trouvait nulle part de réponse. Des lettres postérieures prouvaient qu’Hélène avait sans doute conduit elle-même (après plusieurs incursions des allemands chez les Dessablettes) le petit Rémi X. dans cette grande maison au vaste jardin où l’on pouvait se reposer tranquillement et changer d’air. Les enveloppes portaient le tampon de Paris alors que les billets qu’elles contenaient faisaient référence au monde rural de l’Oise. L’enfant là-bas avait retrouvé des cousins, Riri et Jeannette, un peu plus âgés que lui. Cela ajoutait aux colis qu’Hélène expédiait chaque semaine aux uns et aux autres.
De Nantes on lui réclamait des pommes de terre, de Préfailles de la farine, de Saint-Raphaël (« joli pays où l’on meurt de faim si le porte-monnaie n’est pas gonflé ») de la semoule, d’ailleurs, du sel (sans terre), du beurre. En retour elle recevait un peu de sucre, des rubans pour ses chapeaux, parfois des tickets de rationnement.
A partir de juin 1943 madame Le Chahier et Liselotte Renant étaient redevenues bavardes dans leurs écrits qui comportaient plusieurs pages chaque semaine. Toutes les deux confiaient colis et missives à leurs commissionnaires ou à leurs porteurs, des jeunes gens, dont un au moins était originaire du R. ou des ses environs, qui travaillaient à la construction du mur de l’Atlantique. Ils occupaient toutes les locations de madame Le Chahier, y compris l’étage de sa maison, ce dont elle se félicitait. Certains passaient la nuit à bétonner, de huit heures du soir à huit heures du matin, racontait-elle. « Avec le vent, quel pénible travail. »
L’occupant renforçait ses défenses. Les bombardements alliés s’intensifiaient. Les pénuries de toutes sortes s’aggravaient. On sentait le dénouement proche. L’espoir et l’anxiété atteignaient leur comble. En dépit de l’angoisse, tous soupiraient après le jour de la délivrance. Quand ? Où ? Comment ? Survivrait-on jusqu’aux retrouvailles sur la côte ?
Félicité Dessablettes était revenue passer une semaine chez ses parents, mûrie, profondément marquée par son expérience de la guerre en Loire Inférieure, vaillante malgré tout. Elle incitait Sixtine à la rejoindre comme secouriste ou bien comme ambulancière puisqu’elle savait conduire. Sixtine ne se décidait pas, par peur d’affronter la peur, les blessures abominables, non pas de mourir, mais de voir la mort, de rentrer estropiée ou défigurée. Elle n’aurait pas ce courage.
NB : Ceci est une fiction
 7 commentaires
7 commentaires
-
Par margareth le 26 Mai 2012 à 05:44

Un mois plus tard madame Le Chahier écrivait à son tour longuement. Elle informait ses petites-filles que sa malle et celle de Liselotte Renant étaient arrivées la veille après qu’elles avaient l’une et l’autre entrepris maintes démarches pour savoir ce qu’il en était advenu. Elle leur demandait de conserver ses fourrures qu’elle ne porterait pas cet hiver, disait un mot de ses locataires de l’été, se plaignait de ce que des laissez-passer avaient été exigés pour vendanger sa vigne de la Raize dont elle avait retiré une seule barrique car tout le reste avait été pillé. Par bonheur, celle de Quirouard avait bien donné. Elle ajoutait que les préfaillais, s’ils étaient encore libres de sortir et de rentrer, n’avaient plus le droit de recevoir. D’autre part la ligne de chemin de fer devait être remise en état et prolongée jusqu’à Saint-Gildas. Ce qui nécessiterait l’intervention de nombreux ouvriers à quelques-uns desquels elle espérait louer ses maisonnettes vacantes plutôt que de prendre le risque de les abandonner aux dégradations ou de les voir réquisitionnées.
Au R., les affaires des Delyon allaient bon train. Ils vendaient leurs oies mille francs l’une. Les allemands dans ces transactions se montraient souvent généreux, quelquefois perfides. Et le faubourg alors se gaussait de leurs mésaventures. Il se raconta que des occupants, sur le point de partir, leur en avaient commandé trois. Or, les ayant reçues, ils leur avaient laissé un seul billet de mille francs. D’autres leur en avaient fait tuer une pour, au jour prévu, ne point venir la chercher.
Mais ces considérations ne sont qu’anecdotes au regard des bouleversements qui s’opérèrent dans cet intervalle. Il y a tout lieu de penser que la relation entre Yvonne et Balthasar ne dépassa point le simple flirt. Il ne s’était agi de façon probable que d’une passade. A quelques jours de là Balthasar zu Lobsteinbau annonçait aux sœurs Pochon son départ pour Nantes. Il leur fit ses adieux à l’heure du dîner. Aucune ne détourna la tête de son assiette pour le saluer. L’Oberst Müller lui avait succédé plusieurs jours après. C’était un homme grand et sec dont les tempes grisonnaient. Ses traits hautains exprimaient le mépris absolu qu’il portait à une nation de vaincus. Sauf à l’occasion de commandements, il n’adressait pas la parole à mesdemoiselles Pochon.
A la Mésangère, un soir qu’elle allait enfermer les poules, Marie-Thérèse avait remarqué un faible rai de lumière à la fenêtre d’une chambre inutilisée du second étage. Sans tarder elle avait averti monsieur et madame qui lisaient devant la cheminée. Avant que monsieur Dessablettes ait pu la retenir, leur bonne s’était engagée dans l’escalier, persuadée de la présence d’un rôdeur, parce qu’elle ne croyait pas aux fantômes. Quand elle avait ouvert la porte de la mansarde, la lampe était éteinte, mais des odeurs rances de savon et de nourriture dénonçaient une présence. Elle avait tourné le commutateur. Il n’y avait personne. Cependant elle nota une robe de chambre accrochée à la poignée de la fenêtre, un bout de savon, des brosses à dent, des serviettes et des gants de toilette suspendus de part et d’autre de la table de toilette. Elle crut entendre une exclamation étouffée. A monsieur Dessablettes qui atteignait le palier, elle cria : « Il y a quelqu’un ici ! » Dessablettes de la main lui fit signe de se taire. « Chut ! Venez, nous allons vous expliquer. »

Marie-Thérèse tombait des nues. « Eh ! Ben ! Qui m’aurait dit ? » répétait-elle sans fin. Puis une idée jaillit de son esprit. « Si j’osais, je vous ferais bien une proposition… J’ai une vieille tante dans le Var, à Nice. Vous pourriez y envoyer la dame. Là-bas elle ne risquera rien. Bien sûr, il faut réussir à lui faire passer la ligne de démarcation. Mais après, où ira-t-elle ?
— Ce pourrait être en effet un point de chute. Nous allons y réfléchir et lui en parler.
— Ma tante habite dans le quartier des musiciens. Elle y serait bien.
— Nous en discuterons demain. Mais surtout, Marie-Thérèse, motus et bouche cousue ! Soyez discrète. Vous n’ignorez pas ce que nous encourrons. » Aussitôt dans sa chambre Marie-Thérèse avait pris sa plume pour écrire à sa tante.
La pression allemande s’appesantissait dans la région. Les Dessablettes sentaient l’urgence qu’il y avait à éloigner madame X. et son fils du R. La jeune femme, émaciée par les larmes et l’angoisse, appréhendait ce passage d’une zone à l’autre. Elle refusait d’emmener son fils. Comment s’en sortirait-elle avec un très jeune enfant ? Elle avait supplié le couple de le garder près de lui. Monsieur Dessablettes avait compris qu’elle n’admettrait son départ qu’à cette seule condition, ou bien qu’elle se laisserait mourir. Il activa son réseau qui se chargea de madame X.
Quand huit jours plus tard Marie-Thérèse avait décroché le téléphone, son visage s’était illuminé. Madame X. était arrivée à bon port. Sur la Côte d’Azur elle avait retrouvé de nombreux coreligionnaires et sa tante l’entourait d’attentions. Tour à tour chacun échangea quelques mots avec elle qui se confondait en remerciements et embrassait très, très fort son petit garçon.
Le 11 novembre 1942 les allemands envahissaient la zone libre sauf le Var avec Nice confié aux italiens. Sa mère, raconterait plus tard madame Delyon, qui dans son existence n’avait guère franchi les limites de son canton, s’extasiait devant ce déferlement de troupes : jamais elle n’aurait imaginé qu’il y avait autant de monde sur terre ! Alcide, l’ancien combattant des tranchées, fit une crise cardiaque qui nécessita son hospitalisation chez les bonnes sœurs du R. Yvonne, Hélène et Sixtine versèrent des larmes en secret. Cette nouvelle épreuve s’ajoutait aux chagrins accumulés depuis deux ans et les avivaient. Des plaies mal cicatrisées se rouvraient. De nouveau Olivier hantait les nuits de Sixtine. Saurait-on jamais ce qu’il était devenu ? Sans cette maudite guerre, ils seraient mariés, parents peut-être, et ils vivraient entre Nantes et Préfailles. Elle ne savait plus à quoi s’accrocher. Ses parents étaient morts, son fiancé disparu, sa meilleure amie partie au loin, Liselotte et sa grand-mère, inatteignables… En tendant la main au diable, on avait ouvert les portes de l’enfer.
NB : Ceci est une fiction 9 commentaires
9 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique