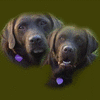-
Par margareth le 4 Avril 2010 à 05:58
La plupart d'entre vous vont penser, à juste titre, que je vous propose en peu de jours un poème illustré d'une peinture que vous connaissez déjà. Mais l'un et l'autre traduisent si bien ce que je ressens en évoquant les souvenirs des fêtes pascales de mon enfance que je ne peux m'empêcher de les publier en ce jour de Pâques. De la fenêtre de notre chambre c'est ainsi que je contemplais le ciel de l'est, du côté de chez M.B., l'amie de grand-mère, tandis que le chant matinal de son coq nous arrivait par vagues successives.

"Pâques approchait… Pâques était là ! Et les vacances de Pâques arrivaient enfin, qui nous ramèneraient vers Préfailles. Par un frais matin de printemps notre oncle nous embarquait avec ses aînés en direction du pays natal. Nous arrivions chez grand-mère avant que la rosée des pelouses ait eu le temps de s’évaporer. L’air vif nous incitait à batifoler dans les allées sous le ciel délicatement transparent de l’aurore. Parfois nous trouvions un gros lézard vert encore engourdi qui menaçait nos doigts de ses minuscules dents aiguës.
Chez grand-mère les cloches ne manquaient jamais de passer le matin de Pâques (grâce à la complicité discrète de M.B.) pendant que nous assistions à la messe et que nous nous arrêtions à la pâtisserie. Elles égrenaient leurs confiseries de chocolat et de sucre au-dessus du jardin au nord. Dès notre retour nous nous éparpillions à leur recherche entre les planches de fleurs et le long des bordures de fusains. De sa fenêtre du premier étage, grand-mère dirigeait nos recherches vers les recoins délaissés. La récolte terminée, par souci d’équité, il fallait redistribuer le trop perçu des uns aux moins pourvus ou aux malchanceux !"
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par margareth le 22 Février 2010 à 05:34
 Il redescendit au premier étage. Le moindre bruit résonnait en écho dans les larges pièces désertes. Quelques rais d’or poussiéreux filtraient à travers
les fentes des persiennes métalliques. Ils éclairaient l’intérieur des chambres juste assez pour distinguer les dégradations du temps : les papiers peints se décollaient par places, les
peintures se fendillaient, les moquettes étaient usées jusqu’à la corde, les plafonds fendus. Olivier contemplait le spectacle de désolation que le déménagement avait révélé. Voilà le peu qui
subsistait de leurs jeunes années. Plus rien bientôt…
Il redescendit au premier étage. Le moindre bruit résonnait en écho dans les larges pièces désertes. Quelques rais d’or poussiéreux filtraient à travers
les fentes des persiennes métalliques. Ils éclairaient l’intérieur des chambres juste assez pour distinguer les dégradations du temps : les papiers peints se décollaient par places, les
peintures se fendillaient, les moquettes étaient usées jusqu’à la corde, les plafonds fendus. Olivier contemplait le spectacle de désolation que le déménagement avait révélé. Voilà le peu qui
subsistait de leurs jeunes années. Plus rien bientôt…
Il se rappela tout à coup que la chambre de leurs parents ne possédait pas de volets et qu’elle était la seule à donner sur la cour. La poignée de laiton avait du jeu, comme par le passé. Il la tourna avec précaution et entra en évitant de faire craquer le parquet verni. Une mouche solitaire errait de bouquet en bouquet sur le fond rose fané de la tapisserie. Alors, une émotion intense, jaillie du plus profond son être, le submergea. Il éprouvait la douleur insondable d’un deuil jamais accompli, enfoui sous les sédiments du temps. Une vie, toute une vie, une existence de trois jours emplissait le vide entre ces murs. Oui, la vie entière de Martine s’était déroulée dans ce lieu il y avait quarante-trois ans. Elle y était née. Elle y avait vécu sa brève découverte du monde. Elle y était morte. Trois nuits ; deux jours… Qui le saurait encore dans quelques mois ? Des étrangers étaient sur le point de prendre leur place. Ils y ancreraient leur propre histoire. Quel était le sens de ces mots : toute une vie ? Ne qualifiaient-ils pas aussi bien la très brève existence d’un bébé de quelques heures que celle, interminable, d’un centenaire ? Toute une vie, qu’était-ce ? L’intervalle qui comblait la distance entre la naissance et la mort. L’expérience unique, même fugace, d’avoir été, d’être apparu et d’avoir affronté l’anéantissement de soi-même. En ce sens, toute vie était pleine d’elle-même, de sa connaissance singulière de l’existence. Un destin unique : le sien.
Que lui arrivait-il ? Ce n’était certes pas son genre de se laisser bouleverser par des états d’âme. Pour son entourage Olivier avait la réputation d’être un garçon positif, plutôt superficiel. Mais, tout au fond de lui-même, nul homme n’est monolithique… Il devait se secouer, revenir à la raison ! Il sortit de la pièce et redescendit dans les ténèbres froides du rez-de-chaussée.
Olivier retira la clef que le soleil fit luire, un bref instant, d’un éclat argenté. Il se retourna. Il prenait ses lunettes de soleil dans la poche de sa chemise quand une grosse femme, qui pouvait avoir plusieurs années de plus que lui, l’aborda :
- Bonjour ! Tu es de retour au pays ? … Tu ne me remets pas ?
Surpris, Olivier hésitait. Ce visage détruit par l’embonpoint n’évoquait pour lui aucun traits connus. La femme ajouta, toujours souriante :- Je suis Marie Annick Desarme, la préparatrice de l’ancienne pharmacie Catz. Vous y veniez souvent !
- En effet, admit-il. C’est curieux, je revois très bien l’intérieur de l’officine, l’agencement des vitrines, mais je suis incapable de la situer…
- Sur la route d’Emporzac, à la place de la banque, précisa-t-elle.
Non, il ne se remémorait rien hormis un décor statique, hors du temps, que n’animait aucune présence. Il s’enquit :- Comment m’as-tu reconnu ?
-Tu ressembles tellement à tes parents qu’il n’y a aucun doute possible … Je me rappelle bien ton frère aussi, celui qui avait une grosse mèche crantée qui lui tombait sur l’œil. Que devient-il ? A-t-il toujours d’aussi beaux cheveux ?
Désarçonné par ces questions inattendues, Olivier réfléchissait. Il avait été le seul des quatre frères à porter une mèche. Toutefois il ne rectifia pas la méprise de son interlocutrice. Il se contenta de répondre :
- Non. Non, il est un peu chauve… Mais, excuse-moi, j’ai un rendez-vous important. Je dois partir.
Ils se dirent adieux au bord du trottoir. Olivier chaussa ses Ray Ban tandis que Marie Annick Desarme poursuivait sa route, vacillante sur ses talons aiguilles.Son âme d’incorrigible séducteur était requinquée. Il repartait flatté qu’un cœur féminin ait conservé, pendant tant de lustres, l’image indélébile du jeune homme qu’il fût. Son être palpitait d’une joie nouvelle. Il se sentait léger, léger, libre enfin, sur le point de se jeter à corps perdu dans la vie, sans contraintes.
Pour la dernière fois il traversa la rue du Pont sous les ultimes feux du soleil automnal, soulagé de quitter pour toujours la terre de leur exil…
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par margareth le 15 Février 2010 à 05:19
Toute une vie.
 Olivier tourna la clef pour couper le contact, serra le frein à main et ouvrit la portière tout en pivotant sur son siège. D’un élan il déplia sa grande
carcasse hors de l’habitacle, les yeux fixés sur le numéro sept de la rue du Pont. Il verrouilla sa voiture d’un geste automatique puis, les mains dans les poches de son pantalon, d’un pas
souple et dégagé, il avança vers la façade austère de la maison qui avait abrité quelques décennies durant l’histoire familiale. Il se sentait léger, enfin libéré pour toujours du poids de
souvenirs pénibles (injonction à se plier aux diktats de leur mère, caractère taciturne de leur père, vastes pièces du rez-de-chaussée plongées dans la pénombre) qui entravaient, aujourd’hui
encore, les élans spontanés de leur vie. Pourtant tous avaient atteint ou dépassé la cinquantaine. Les oisillons s’étaient envolés loin, très loin, aussi loin que possible du nid. Mais, comme
l’œil poursuivait Caïn où qu’il aille, la vieille demeure et ses fantômes restaient tapis dans un coin reculé de leur être, toujours prêts à surgir à l’instant le plus importun. Olivier sourit à
cette pensée. Les amarres allaient être larguées. Il allait enfin pouvoir mener sa barque selon son bon plaisir !
Olivier tourna la clef pour couper le contact, serra le frein à main et ouvrit la portière tout en pivotant sur son siège. D’un élan il déplia sa grande
carcasse hors de l’habitacle, les yeux fixés sur le numéro sept de la rue du Pont. Il verrouilla sa voiture d’un geste automatique puis, les mains dans les poches de son pantalon, d’un pas
souple et dégagé, il avança vers la façade austère de la maison qui avait abrité quelques décennies durant l’histoire familiale. Il se sentait léger, enfin libéré pour toujours du poids de
souvenirs pénibles (injonction à se plier aux diktats de leur mère, caractère taciturne de leur père, vastes pièces du rez-de-chaussée plongées dans la pénombre) qui entravaient, aujourd’hui
encore, les élans spontanés de leur vie. Pourtant tous avaient atteint ou dépassé la cinquantaine. Les oisillons s’étaient envolés loin, très loin, aussi loin que possible du nid. Mais, comme
l’œil poursuivait Caïn où qu’il aille, la vieille demeure et ses fantômes restaient tapis dans un coin reculé de leur être, toujours prêts à surgir à l’instant le plus importun. Olivier sourit à
cette pensée. Les amarres allaient être larguées. Il allait enfin pouvoir mener sa barque selon son bon plaisir !
C’était une belle journée d’arrière-saison. L’air vibrait sous la chaleur quasi-estivale du soleil, le lointain flottait au-dessus de l’horizon. Le regard caché derrière la barre noire de ses Ray Ban, Olivier feignait d’examiner avec une attention méticuleuse quelque objet au-dessus du toit. Mieux valait ignorer telles silhouettes qu’il croyait avoir oubliées depuis longtemps… Il disposait de deux heures avant son rendez-vous dans l’étude de Maître Ginger où, mandaté par ses frères et sœurs, il signerait l’acte de vente et remettrait les clefs aux nouveaux propriétaires. Seul et désœuvré, il avait pris la décision de faire un dernier tour de la maison vide.
La serrure était grippée. Il pesa sur la clef jusqu’à ce que la porte cédât. Alors, d’un coup, la lame froide et humide de l’air confiné le retrancha du monde extérieur. Ses pas résonnaient sur le carrelage glacé, entre les murs nus, cloqués de salpêtre. Mobilier et cloisons avaient beaucoup soufferts pendant les derniers hivers d’abandon. Il était devenu urgent de vendre leur bien.
Olivier poussa la porte de la salle à manger. Démeublée, il la retrouvait identique à ce qu’elle avait été à leur arrivée ici, dans un bourg perdu, lorsqu’il avait cinq ans : démesurée, profonde comme une grotte, à peine éclairée par une étroite fenêtre au nord. Tous les enfants Lenoble s’accordaient sur le fait que les dimensions des pièces leur avait laissé une impression inoubliable quand ils les avaient visitées pour la première fois. Il traversa la cuisine de proportions aussi généreuses. Une cuisine à l’ancienne dans laquelle les femmes s’activaient pendant des heures à une époque où n’existaient ni frigidaire ni four à micro-ondes. Il sortit dans la cour, puits cerné de bâtiments que la lumière du soleil ne faisait qu’effleurer en hiver et que, l’été, elle traversait en plein midi, juste le temps d’incendier le vieux mur de briques, la treille et les rangs de potées joliment étagés à leur pied. L’embrasement à l’heure méridienne ne parvenait jamais à repousser la ligne d’ombre qui noyait la presque totalité de la cour. Olivier observait en cet instant ce monde gris, minéral, de ciment et de murs ternes, privé de la maigre végétation qui l’égayait autrefois. C’était ainsi qu’il l’avait connu dans son enfance, humide et malsain. Leur mère s’en désolait. Elle n’aimait pas les voir jouer dans ce « trou » nauséabond. Les six enfants Lenoble s’en accommodaient car le ciel bleu au-dessus de leurs têtes s’ouvrait jusqu’à l’infini, traversé de vols et de chants d’oiseaux, moutonnant de nuages blancs pleins de chimères et d’êtres fantasmagoriques. Là-haut le vent brassait des rêves d’horizons sans limite, de mers innombrables, de continents inexplorés. Un jour, ils le savaient, ils s’évaderaient de leur étroite citadelle pour vivre d’étonnantes aventures.
Aujourd’hui comme hier la deuxième latte du plancher, sur le palier, grinça quand il y posa le pied – bruit si incrusté dans la mémoire de ses sens que son absence l’eût inquiété. Il faisait presque nuit dans cet espace à peine éclairé par le minuscule oculus de verre dépoli qui donnait sur l’ancien cabinet de toilette de leurs parents. Olivier devinait, plus qu’il ne les voyait, les portes ocre des chambres ainsi que les premières marches de l’escalier qui menait au grenier. Il s’y engagea allègrement. Il retrouvait la sensation de bonheur intense de son adolescence, quand il parvenait à s’échapper en secret pour se faufiler jusqu’au fatras d’héritages successifs accumulés, là-haut, au fil de la disparition de parents sans postérité. Il y discernait des merveilles, des mystères, une poussière de vies éteintes. Les souris creusaient leurs nids à l’intérieur des vieux matelas entassés derrière la porte. On les entendait trotter dès qu’on la franchissait. Au fond d’un carton avachi, parmi des paquets de lettres enrubannés, il se rappelait avoir découvert une carte postale anonyme adressée à son arrière-grand-mère. Une main élégante y avait tracé : Adèle, devinez qui vous aime. Rien de plus. Il avait passé des heures romantiques suspendu à cette phrase. Qui était le mystérieux expéditeur ? Qu’avait éprouvé son aïeule en la recevant ? Désormais personne, jamais plus, ne le saurait.
Olivier ouvrit la porte sur l’espace dégarni. Un beau volume aménageable, avait souligné l’agent immobilier : huit mètres entre le plancher et le faîte ; quatre-vingts mètres carrés au sol ! Il en eut le vertige. Tout avait disparu de son monde encombré des restes du temps qui passe. Il fit quelques pas. L’ardeur du soleil cuisait les ardoises au-dessus de sa tête. Il transpirait. Il ôta sa veste et, d’un geste circulaire du poignet, il la jeta négligemment sur son épaule en la retenant du bout des doigts. Une chauve-souris dérangée dans son sommeil le frôla puis retourna s’accrocher dans un coin obscur.
La porte du chien-assis était entrebâillée. Il s’approcha du grillage qui le fermait. Le soleil baignait un petit val en contrebas où était aménagé un joli parc soigné. Le velours vert de son gazon luisait entre les buissons de rosiers et de rhododendrons. Trois grands palmiers autour d’un banc de fonte y apportaient une note exotique. La dernière fois que son père était monté ici, il lui avait confié : « De temps en temps, avec ta mère, nous venions admirer le jardin en bas. Il nous faisait envie ! Mais à l’époque, ce n’était pas possible. » Un silence. Et il avait soupiré : « Oui, nous avons tiré le diable par la queue… (Il prononçait djable, comme s’il crachait le mot) »
Soudain, à cette évocation, l’image de ses parents, sévères et rétrogrades, se lézarda. Pour la première fois Olivier prenait conscience qu’eux aussi avaient été jeunes et complices. Il les voyait à cette même place, penchés au-dessus de leur rêve inaccessible. Leurs ambitions restaient modestes –c’est bien ce que leur reprocheraient plus tard les enfants, acharnés à réussir. Elles n’allaient guère au-delà des plaisirs simples de la vie de famille. Il imaginait leur vœu jamais réalisé. Celui d’une brèche ouverte entre leur cour infecte et le jardin plein de soleil ; une entrée d’air pur et de lumière. Tous auraient profité d’un bout de campagne où cultiver des légumes, s’ébattre et pique-niquer. Olivier se souvint alors que leur mère chantait souvent, qu’elle riait aussi. Il se rappela la joie de leur père lorsqu’il leur avait offert du champagne pour la première fois, au début de leur adolescence. Il l’admettait enfin : ils avaient été des enfants heureux, non pas gâtés, mais entourés d’attentions. Leurs parents, comme la plupart des gens de leur génération, manifestaient peu leurs sentiments. Cependant il était certain d’avoir été aimé. Il était sûr maintenant qu’ils avaient agi au mieux pour le bien-être des enfants. Fallait-il donc avoir parcouru les deux tiers de mon existence ? Fallait-il donc qu’ils nous aient quittés, pour les comprendre enfin ? pensa-t-il. En bas, la cavité d’ombre contrastait avec le jardin blême de lumière. Ainsi, la vieillesse souffreteuse, amère de ses parents, qui n’occupaient plus que le rez-de-chaussée de leur trop grande maison devenue silencieuse, avait occulté les lointaines années de bonheur…
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique